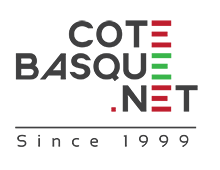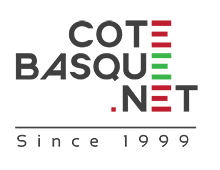Comme tous les amoureux du blog Pays basque, c'est vrai que nous l'aimons cette terre basque, pour son histoire, pour ses habitants, leur culture, leur langue et leurs traditions, mais nous la chérissons aussi pour ses paysages. Et la nature a été particulièrement généreuse avec le Pays basque. Elle nous a légué un inestimable capital, tant par sa qualité que par sa variété. Gorges et cols de la haute Saule, Sierras navarraises, diversité des vallées, et même un désert aux Bardenas, et puis bien sûr de l’embouchure de l’Adour & celle du Nervion, plus de deux cents kilomètres d ’un littoral qui offre quelques-uns des plus beaux sites d’Europe : Biarritz, Anglet, la baie de Txingudi, la Concha à Donostia San Sebastian, Mundaka et sa célèbre vague, la liste est longue et jamais exhaustive. Il suffit de parcourir la montagne du Pays basque, de discuter avec les bergers, ou pour ceux qui ont ce bonheur, avec les derniers habitants de la vallée d’Uritzate pour comprendre à quel point ils respectent leur environnement, à quel point ils aiment cette terre léguée par leurs parents et qu’ils veulent transmettre, à leur tour, à leurs enfants, comme un héritage de famille. Ils savent qu’ils sont le maillon d ’une longue chaîne qu’aucun ne voudrait prendre le risque de briser. Et ils savent aussi, pour la côtoyer à chaque instant, que la nature est une compagne exigeante et fragile.
Sans aucun doute, il y a sur cette terre basque un petit quelque chose de différent, un supplément d’âme qui la rend irremplaçable. La variété de ses paysages y participe bien sûr : de la haute montagne souletine aux contreforts pyrénéens qui s’alanguissent dans l’océan, des vallées navaraises encaissées qui voisinent avec le désert des Bardenas, des paysages méditerranéens de l’Alava à ceux, urbains, de Donostia, Bilbao, Bayonne ou Biarritz, et bien sûr.
Autant d’invitations à la découverts et au farniente. Il y a aussi cette architecture, décor préservé, comme un pied de nez à la logique du tout béton qui sévit ailleurs. Et puis, et surtout, il y a les Basques eux-mêmes, qu’une frontière n’est jamais parvenue à séparer. Ils ont su, au fil des siècles conserver leur identité, leur culture, leurs chants, leurs fêtes et leur langue. Mais ne cherchez ici nul folklore. Ces gamins qui chantent et dansent comme leurs aînés le font parce qu’ils ont conscience d’être les maillons d’une chaîne qui a traversé les siècles et leur survivra. À l’heure de la mondialisation, des stéréotypes et de la culture, cela fait du bien de rencontrer cet îlot de résistante. Ce pays d’hommes rudes et de taureaux. Bienvenue sur le blog Pays basque